La lunette trauma : une approche clé pour soutenir les fonctions exécutives des enfants
Les fonctions exécutives (FE), qui progressent rapidement entre trois et sept ans (Castellanos-Ryan et al., 2023), représentent le chef d’orchestre du cerveau ; elles coordonnent les différents instruments (les habiletés liées aux FE) pour créer une symphonie (un comportement adapté à la situation qui permet d’atteindre un but). Cet article présente une approche sensible au trauma pour soutenir les fonctions exécutives des enfants exposés à des expériences d’adversité à l’enfance, en plus de proposer des actions concrètes pour soutenir tous les enfants en classe.

Source de l’image : Shutterstock
Qu’est-ce que les fonctions exécutives ?
Définies comme des processus cognitifs de haut niveau, les FE permettent entre autres à l’enfant de faire face à des défis, de résister aux tentations et de planifier des actions (Diamond, 2013 ; 2016).
Les principales composantes des FE sont :
- l’inhibition : la capacité de contrôler ses actions, pensées et émotions pour agir selon les demandes environnementales (Bjorklund et Causey, 2018) ;
- la mémoire de travail : la capacité de retenir et de manipuler des informations pendant une courte période pour réaliser une tâche ou s’engager dans une situation (Baddeley, 2000) ;
- la flexibilité cognitive : la capacité de passer d’une action ou d’une situation à une autre et de s’adapter aux demandes environnementales (Chevalier, 2010) ;
- la planification : la capacité de prévoir, d’évaluer et de coordonner des actions pour atteindre un objectif (Revel, 2011).
Les FE constituent une assise sur laquelle s’appuient tous les domaines du développement global de l’enfant, contribuant à sa réussite éducative dès l’entrée à l’école. C’est pourquoi les documents ministériels, dont le Programme-cycle de l’éducation préscolaire (MEQ, 2023), recommandent à la personne enseignante de soutenir les enfants dès l’âge préscolaire, reconnu comme une période sensible du développement (Hodel, 2018). L’importance de soutenir les FE est d’autant plus cruciale chez les enfants exposés à des facteurs de vulnérabilité, telles les expériences d’adversité à l’enfance (EAE).
Quand le stress laisse des traces : l’effet des expériences d’adversité à l’enfance
Les EAE, telles que la négligence ou l’abus, constituent une source de stress substantielle, mettant en péril la sécurité physique et le bien-être psychologique de l’enfant (Jackson et al., 2021). Les EAE peuvent entraver son développement global, dont les FE (Op den Kelder et al., 2018). Des travaux ont d’ailleurs montré que les EAE sont susceptibles d’altérer le développement des FE (Comtois-Cabana et al., 2022), témoignant l’importance de se questionner sur les manières dont les enseignants et enseignantes peuvent les soutenir chez tous les enfants, dont ceux exposés à des EAE. En ce sens, adopter une approche sensible au trauma semble une piste prometteuse.
Regarder au-delà du comportement : miser sur une approche sensible au trauma
Un principe clé d’une approche sensible au trauma auprès d’un enfant exposé à des EAE est de comprendre « ce qui lui est arrivé » plutôt que de chercher « ce qui ne va pas chez lui » (Milot et al., 2018). Cette approche permet de reconnaître que certains comportements qui peuvent être jugés dérangeants (p. ex., interrompre la personne enseignante) peuvent en réalité être des réactions adaptatives que l’enfant a développées en raison de ses expériences passées. Le projet Healthy Environments and Response to Trauma in Schools (HEARTS) est un bon exemple de cette approche en milieu scolaire : en se concentrant sur le vécu des enfants et en adoptant une lunette sensible au trauma, une baisse significative de 89 % du recours aux suspensions a été observée (Dorado et al., 2016). L’école, en tant qu’institution sociale, joue un rôle crucial dans le soutien au développement des enfants, notamment ceux exposés à des EAE, en créant un environnement bienveillant et sécurisant (Milot et al., 2018). Dans ce cadre, la personne enseignante devient un acteur essentiel en termes de soutien aux FE, lesquelles interviennent quotidiennement auprès des enfants, dont ceux exposés à des EAE. La section suivante présente quelques pistes d’actions concrètes que peut mettre en place la personne enseignante afin de soutenir les FE de tous les enfants de sa classe.
Des actions concrètes pour soutenir les enfants
- Créer un environnement prévisible et sécurisant : des routines claires et un climat de confiance aident les enfants à se sentir en sécurité. Ce sentiment de sécurité encourage l’exploration de l’environnement et la prise d’initiatives, deux éléments qui favorisent le déploiement des FE.
- Soutenir le développement de la conscience émotionnelle : aider les enfants à identifier et à comprendre leurs émotions leur permet de mieux les gérer, en mettant notamment à profit leur inhibition. Des activités de relaxation, de méditation ou de yoga peuvent être bénéfiques.
- Soutenir les capacités d’organisation et de planification : fournir des outils visuels (p. ex. pictogrammes), des aide-mémoires et décomposer les tâches en petites étapes peuvent aider les enfants à mieux s’organiser (p. ex. matériel, temps) et, par le fait même, à mobiliser leurs FE comme la mémoire de travail et la planification.
- Favoriser la flexibilité cognitive : encourager les enfants à envisager différents points de vue et à trouver des solutions alternatives stimule leur capacité d’adaptation, sollicitant notamment leur flexibilité cognitive.
- Miser sur les forces de l’enfant : axer sur les capacités des enfants et reconnaître leurs efforts et leurs progrès (même petits) renforce leur confiance et leur motivation, les incitant à prendre des risques et à mobiliser leurs FE.
- Collaborer avec les familles et les ressources communautaires : mobiliser les différents milieux de vie et les figures parentales dans la réussite éducative des enfants est essentiel pour soutenir leur développement, dont leurs FE.
Enfin, en adoptant une approche sensible au trauma et en mettant en place des interventions personnalisées aux besoins individuels des enfants, la personne enseignante peut les aider à soutenir leur développement et, par extension, favoriser la mobilisation des FE dans la classe. Des pratiques tenant compte du vécu des enfants et favorisant la création d’environnements sécurisants offrent à chacun la possibilité d’atteindre son plein potentiel.
Références
Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in cognitive sciences, 4(11), 417-423. https://doi.org/10.1016/s1364-6613(00)01538-2
Bjorklund, D. F. et Causey, K. B. (2018). Children’s Thinking: Cognitive Development and Individual Differences. Sage Publications.
Castellanos-Ryan, N., Séguin, J. R., Vitaro, F., Parent, S., Tremblay, R. E. et Boivin, M. (2023). Modelling executive function across early childhood: Longitudinal invariance, development from 3.5 to 7 years and later academic performance. Cognitive Development, 68, 101365. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2023.101365
Chevalier, N. (2010). Les fonctions exécutives chez l’enfant : Concepts et développement. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 51(3), 149-163. https://doi.org/10.1037/a0020031
Comtois-Cabana, M., Matte-Landry, A., Cantave, C. Y., Provençal, N., & Ouellet-Morin, I. (2022). À la recherche des mécanismes neurophysiologiques impliqués dans l’émergence des difficultés émotionnelles et du comportement en contexte de maltraitance. Dans Dubois-Comtois, K., St-Laurent, D., & Cyr, C. (dir.). La maltraitance : Perspective développementale et écologique-transactionnelle. Les Presses de l’Université du Québec.
Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review of Psychology, 64(1), 135‑168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750
Diamond, A. (2016). Why improving and assessing executive functions early in life is critical. Dans J. A. Griffin, P. McCardle, & L. S. Freund (dir.), Executive function in preschool-age children: Integrating measurement, neurodevelopment, and translational research. (p. 11‑43). American
Dorado, J. S., Martinez, M., McArthur, L. E. et Leibovitz, T. L. (2016). Healthy environments and response to trauma in schools (HEARTS): A whole-school, multi-level, prevention and intervention program for creating trauma-informed, safe, and supportive schools. School Mental Health, 8, 163-176.
Hodel, A. S. (2018). Rapid infant prefrontal cortex development and sensitivity to early environmental experience. Developmental Review, 48, 113-144. https://doi.org/10.1016/j.dr.2018.02.003
Jackson, D. B., Testa, A., & Vaughn, M. G. (2021). Adverse childhood experiences and school readiness among preschool-aged children. The Journal of Pediatrics, 230, 191-197.e5. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.11.023
Milot, T., Lemieux, R., Berthelot, N. et Collin-Vézina, D. (2018). Les pratiques sensibles au trauma. Dans T. Milot, D. Collin-Vézina & N. Godbout (dir.), Trauma complexe : Comprendre, évaluer et intervenir (252-267). Collection d’enfance, PUQ.
Ministère de l’Éducation du Québec (2023). Programme-cycle de l’éducation préscolaire. Éducation préscolaire, enseignement primaire, gouvernement du Québec. http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/prescolaire/
Op den Kelder, R., Van den Akker, A. L., Geurts, H. M., Lindauer, R. J. L., & Overbeek, G. (2018). Executive functions in trauma-exposed youth: a meta-analysis. European journal of psychotraumatology, 9(1), 1450595. https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1450595
Revel, P. (2011). Essai de rééducation psychomotrice du déficit d’inhibition par le biais d’activités corporelles et motrices. Université Paul Sabatier.
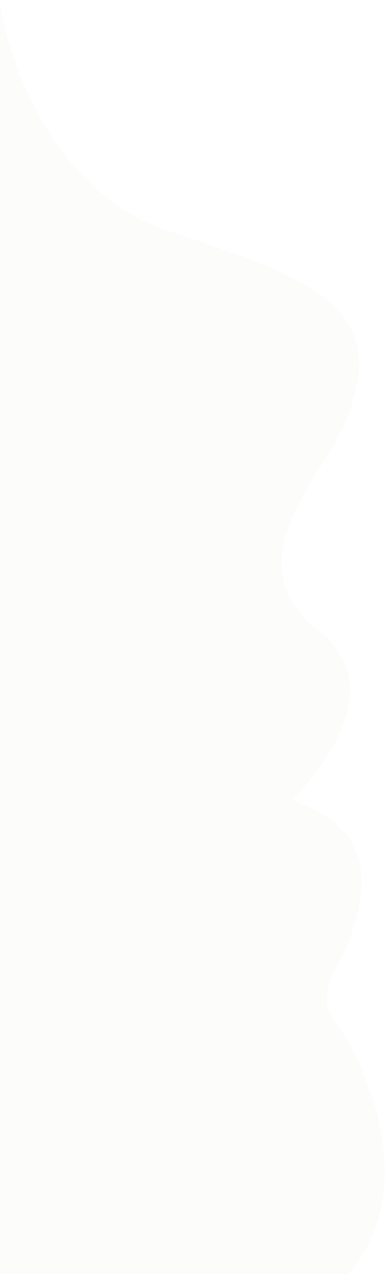
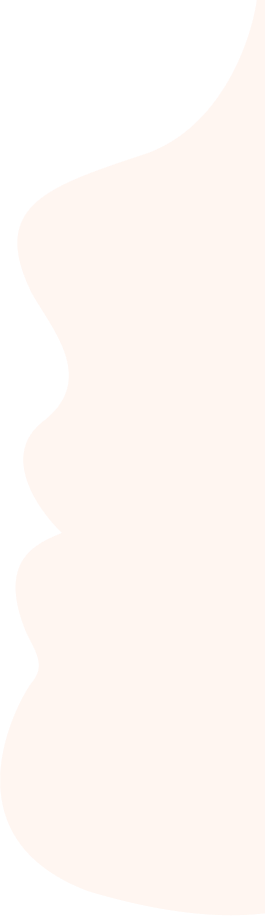
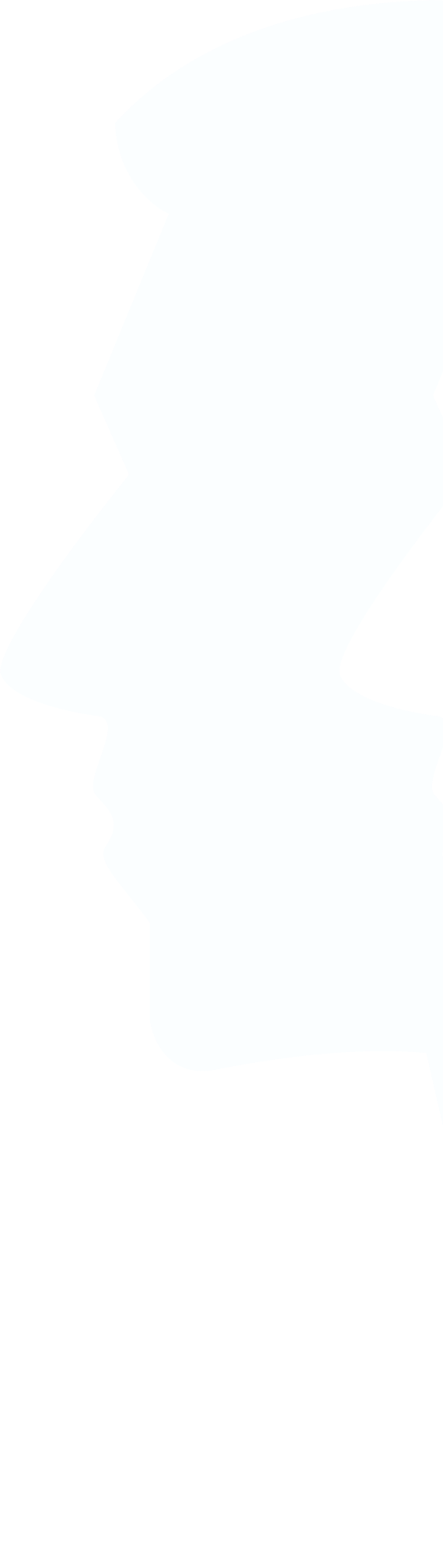
Articles similaires
Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité
Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.
Voir l’articleWikipédia dans la classe
L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.
Voir l’articleApprendre le sens des mots : un défi pour plusieurs enfants
Dans le cadre de l’expérimentation, les enfants avaient besoin de plusieurs séances d’enseignement pour apprendre le sens de la plupart des mots.
Voir l’articleCommentaires et évaluations
Contribuez à l’appréciation collective
