Enseigner la syntaxe en contexte numérique
Cet article s’intéresse à l’enseignement de la syntaxe en contexte numérique. Bien que cet article porte principalement sur le contexte du secondaire, il propose des éléments applicables à d’autres niveaux scolaires. Afin de bien cerner le contexte, des fondements de la grammaire moderne et le concept de maturité syntaxique sont présentés. Enfin, des pistes didactiques en modalités numériques sont proposées tout en précisant les différentes limites des outils numériques pour l’enseignement de la syntaxe.

Source de l’image : Shutterstock
Cet article aborde différents contenus présentés dans la conférence ayant pour titre Comment s’améliorer en syntaxe en contexte d’écriture numérique ? présentée par Katrine Roussel dans le cadre des conférences Scientifiquement scolaire du CEAP-UQAM.
La grammaire moderne
L’enseignement de la syntaxe, notamment au secondaire québécois, doit s’appuyer sur la grammaire moderne. Celle-ci donne la priorité aux grandes régularités du système français et aux propriétés syntaxiques et morphologiques. Elle met également l’accent sur le groupe et sur la phrase comme unités syntaxiques.
Dans ce cadre, les principaux outils d’analyse sont le modèle de la phrase de base et les manipulations syntaxiques, surtout celles dites décisives, combinés à l’emploi du métalangage grammatical. Avec ces outils, les élèves peuvent développer un raisonnement grammatical complet qui leur permet de réfléchir sur la langue en formulant et en testant des hypothèses.
(Boivin et Pinsonneault. 2020 ; Lord et Élalouf, 2016 ; Fisher et Nadeau, 2014 ; Nadeau et Fisher, 2006 ; Tellier, 2016).
La maturité syntaxique
En même temps qu’on enseigne aux élèves du secondaire à développer leurs raisonnements grammaticaux, une évolution naturelle de leur compétence syntaxique s’opère. Il s’agit du processus de maturation syntaxique. À la fin du secondaire, il existe trois indicateurs de maturité syntaxique dans le texte des élèves :
- L’augmentation du nombre de constituants par phrase syntaxique ;
- La complexification de la structure de la phrase ;
- Une plus grande liberté dans la position des constituants.
Il est à noter que la maturité syntaxique n’est pas nécessairement associée à l’augmentation de mots par phrase, comme la condensation de l’information est aussi un signe d’expertise. Elle est également indépendante du nombre d’erreurs.
(Boivin et coll., 2017 ; Hunt, 1965 ; Paret, 1991).
Pistes didactiques en modalité numérique
La combinaison de phrases
La combinaison de phrases est une activité qui contribue significativement à la maturation syntaxique des élèves (Nadeau et coll., 2021 ; Quevillon Lacasse, 2023 ; Quevillon Lacasse et coll., 2018 ; Saddler, 2005, 2019). À partir d’un texte composé de phrases simples, les élèves sont invités à créer un texte plus mature. Il s’agit alors d’une activité de réécriture contextualisée qui offre de nombreuses possibilités. Par un travail d’enrichissement syntaxique et non de correction syntaxique, elle favorise un rapport positif à la langue. Cette activité peut être grandement facilitée par le numérique :
- Rédaction à l’ordinateur (avec ou sans suivi de modifications) ;
- Dépôt sur un environnement numérique d’apprentissage ;
- Manipulation de phrases au tableau blanc interactif.
Dans tous les cas, il est essentiel d’amener les élèves à identifier les procédés de combinaison employés dans leurs textes à la suite d’un modelage de la personne enseignante. Une discussion en grand groupe est également à privilégier pour revenir sur quelques exemples intéressants.
Les outils numériques interactifs
Récemment, une recension des outils numériques interactifs pour l’analyse grammaticale a été effectuée (Arseneau et Geoffre, 2022). Cette recension a permis de constater que les outils proposaient surtout des corpus de phrases préconstruites, des tâches de classification, très peu de tâches de modification ou de justification et que peu d’outils ciblaient les phrases transformées ou complexes. Les outils proposaient des activités non authentiques et cloisonnées, offrant ainsi des tâches de bas niveau peu optimales pour développer les raisonnements grammaticaux, contrairement aux approches actuelles en didactique de la grammaire, qui privilégient que les différents phénomènes grammaticaux se côtoient et que les manipulations se combinent dans une même activité. Ainsi, en proposant aux élèves des outils numériques interactifs pour l’analyse grammaticale, on peut s’attendre à ce qu’ils effectuent des exercices, mais il n’y a aucune garantie d’apprentissages transférables dans des tâches de plus haut niveau, telles que la production et la correction de textes.
Les correcteurs informatisés
L’étude de Grégoire (2018) avait pour objectif, entre autres, de voir si les correcteurs informatisés pouvaient aider les élèves à commettre moins d’erreurs syntaxiques qu’en modalité manuscrite. Ses résultats indiquent toutefois que non : les élèves ayant recouru au traitement de texte avec un correcteur intégré ou à un correcticiel, avec ou sans formation préalable, n’ont pas vu leurs performances en syntaxe s’améliorer. Il est possible que les élèves ne possèdent pas les habiletés métasyntaxiques nécessaires pour véritablement tirer profit de ces ressources, que la formation offerte ait été trop courte pour observer un gain, ou encore que les erreurs de syntaxe soient moins bien détectées par ces outils, contrairement aux erreurs orthographiques.
Les IA génératives ?
Katrine Roussel (2024 a, 2024 b, 2025) a mené une étude exploratoire sur la rétroaction en syntaxe auprès de cinq systèmes d’intelligence artificielle générative (IAG). Les IAG avaient reçu la consigne suivante pour une lettre d’opinion de 500 mots : « Voici un texte contenant uniquement des erreurs de syntaxe. Révise seulement la syntaxe et justifie chaque changement ».
Le constat général est que la rétroaction syntaxique des IAG est, à ce jour, trop fluctuante entre les itérations et pas assez précise pour être satisfaisante sur le plan didactique. Rappelons également que les IAG « hallucinent » parfois. Il est alors possible qu’elles indiquent des erreurs où il n’y en a pas. De plus, même si la consigne demande la révision de la syntaxe uniquement, il a été observé que les IAG révisaient également le vocabulaire et le style selon des critères subjectifs.
Le recours à des IAG dans l’enseignement et la rétroaction de la syntaxe nécessite alors un encadrement adéquat pour réellement mobiliser la compétence métatechnolinguistique (Guichon, 2024). Pour rendre les outils de type IAG pertinents pour s’améliorer en syntaxe, il est possible de :
- partir de cas problèmes générés par l’IAG ;
- prioriser une utilisation collective pour engager des discussions ;
- bonifier les propositions à l’aide d’autres ressources linguistiques ;
- valider les raisonnements syntaxiques.
Conclusion
Pour terminer, il y a encore beaucoup d’études à mener au sujet de l’écriture en contexte numérique. Les outils numériques peuvent avoir un grand potentiel dans certaines conditions, mais des explorations sont toujours nécessaires. De plus, avec la constante évolution des technologies, il est difficile de tout maîtriser. En revenant aux bases de la grammaire moderne et en gardant en tête le concept de maturité syntaxique, il est possible de garder le cap pour viser le développement des compétences syntaxiques des élèves.
Références
Arseneau, R. et Geoffre, T. (2022). Quel potentiel des outils numériques pour le raisonnement grammatical des élèves ? Revue systématique et exemples
d’outils numériques pour les apprentissages grammaticaux. 89e Congrès de l’Acfas. Université Laval.
Boivin, M.-C. et Pinsonneault, R. (2020). La grammaire moderne. Description grammaticale du français (2e éd.). Chenelière éducation.
Boivin, M.-C., Roussel, K. et Pinsonneault, R. (2017). Phrases complexes et maturité syntaxique : une comparaison entre des écrits d’élèves de 13 et 16 ans. Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues (55), 1-21. http://lidil.revues.org/4206
Fisher, C. et Nadeau, M. (2014). Usage du métalangage et des manipulations syntaxiques au cours de dictées innovantes dans des classes du primaire. Repères (49), 169-191. https://doi.org/10.4000/reperes.742
Grégoire, P. (2018). L’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction en contexte d’écriture numérique. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. https://pascalgregoire.files.wordpress.com/2018/02/gregoire_2018.pdf
Guichon, N. (2024). Sur les traces de Richard Kern: Acknowledging the pivotal role of technologies in language education. Modern Language Journal (108), 563-566. https://doi.org/10.1111/modl.12931
Hunt, K. W. (1965). Grammatical structures written at three grade levels (3). https://eric.ed.gov/?id=ED113735
Lord, M.-A. et Élalouf, M.-L. (2016). Enjeux de l’utilisation de la métalangue en classe de français. Dans S.-G. Chartrand (dir.), Mieux enseigner la grammaire : pistes didactiques et activités pour la classe (p. 63-79). ERPI.
Nadeau, M. et Fisher, C. (2006). La grammaire nouvelle : la comprendre et l’enseigner. Chenelière Éducation.
Nadeau, M., Giguère, M.-H. et Fisher, C. (2021). Expérimentation de dispositifs didactiques en syntaxe et en ponctuation « à la manière » des dictées métacognitives et interactives, au 3e cycle primaire et 1er cycle secondaire et effet sur la compétence en écriture. Gouvernement du Québec. https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/experimentation-de-dispositifs-didactiques-en-syntaxe-et-en-ponctuation-a-la-maniere-des-dictees-metacognitives-et-interactives-au-3e-cycle-primaire-et-1er-cycle-secondaire-et-effet-sur/
Paret, M.-C. (1991). La syntaxe écrite des élèves du secondaire. Université de Montréal, Faculté des sciences de l’éducation.
Quevillon Lacasse, C. (2023). Effets d’un enseignement intersyntaxique en anglais langue d’enseignement et en français langue seconde sur les habiletés syntaxiques à l’écrit et la conscience métasyntaxique et intersyntaxique d’élèves du secondaire (thèse de doctorat non publiée). Université du Québec à Montréal, Archipel. https://archipel.uqam.ca/17412/
Quevillon Lacasse, C., Nadeau, M. et Giguère, M.-H. (2018). La combinaison de phrases : un dispositif stimulant et efficace pour développer la créativité syntaxique. Correspondance, 23(5). http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/la-combinaison-de-phrases-un-dispositif-stimulant-et-efficace-pour-developper-la-creativite-syntaxique/
Roussel, K. (2025, soumis). Une étude comparative exploratoire du potentiel de rétroaction de systèmes d’intelligence artificielle générative pour soutenir la révision de la syntaxe. Repères, 72, Le numérique en didactique du français : objets et pratiques d’enseignement, 17 pages.
Roussel, K. (2024 a). Quel potentiel de rétroaction ChatGPT recèle-t-il pour les erreurs de syntaxe ? Les Cahiers de l’AQPF, 15(1), 27-31.
Roussel, K. (2024 b, mai). Intelligence artificielle et didactique de l’écriture : quel potentiel pour soutenir la révision de la syntaxe ? Colloque Écritures numériques dans les classes : des pratiques émergentes aux pratiques instituées ? 91e Congrès de l’Acfas. Ottawa. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10595.57121
Saddler, B. (2019). Sentence Construction. Dans S. Graham, C. A. MacArthur et M. Hebert (dir.), Best Practices in Writing Instruction (3e éd., p. 240-260). The Guilford Press.
Saddler, B. (2005). Sentence combining: A sentence-level writing intervention. The Reading Teacher, 58(5), 468-471. http://doi.org.10.1598/rt.58.5.6
Tellier, C. (2016). Éléments de syntaxe du français : méthodes d’analyse en grammaire générative (3e éd.). Chenelière éducation.
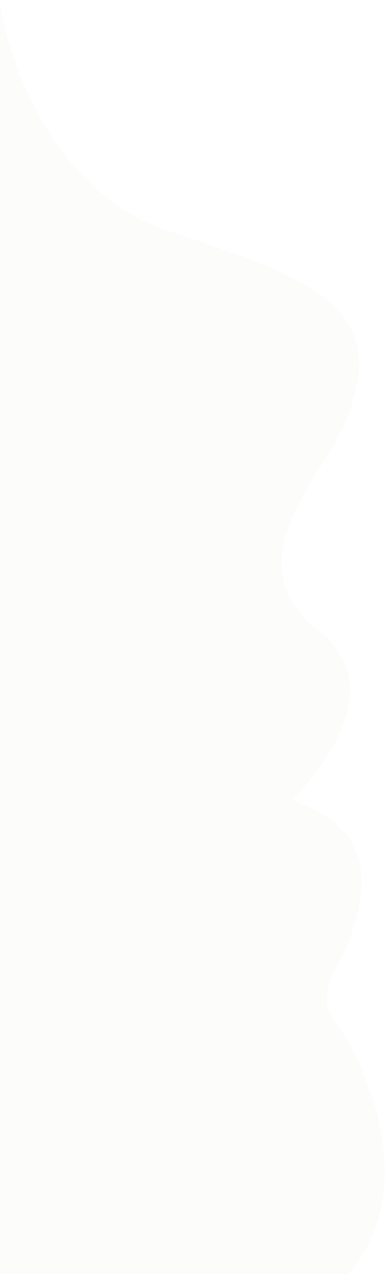
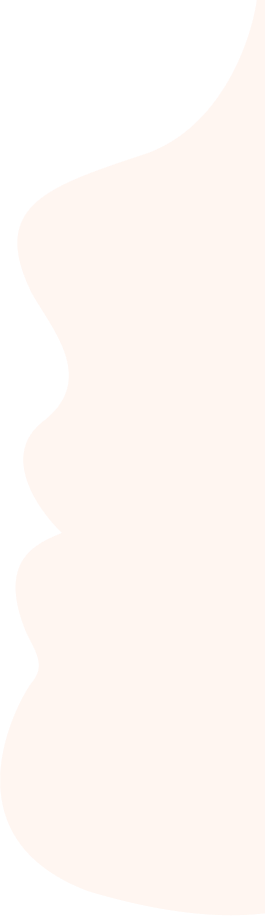
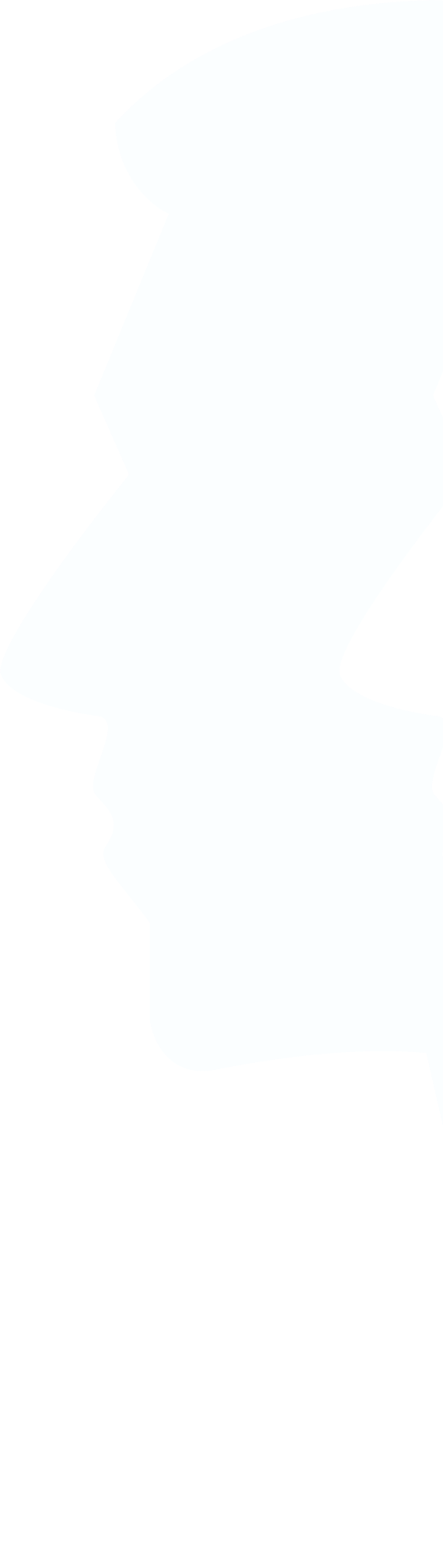
Articles similaires
Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité
Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.
Voir l’articleWikipédia dans la classe
L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.
Voir l’articleApprendre le sens des mots : un défi pour plusieurs enfants
Dans le cadre de l’expérimentation, les enfants avaient besoin de plusieurs séances d’enseignement pour apprendre le sens de la plupart des mots.
Voir l’articleCommentaires et évaluations
Contribuez à l’appréciation collective
