Des stratégies pour créer des ponts entre la recherche et l’enseignement
Le paysage éducatif change à grande vitesse : diversité étudiante toujours plus marquée, exigences accrues en matière d’inclusion, défis de motivation et de persévérance scolaire qui se multiplient. Face à ces enjeux, la recherche en pédagogie propose des solutions concrètes, à condition qu’elles circulent, soient comprises et mises en œuvre. Souvent perçue comme distante ou trop théorique, ce type de recherche peine néanmoins à trouver sa place dans les pratiques.
Ce fossé, pourtant, n’a rien d’inévitable. Des stratégies existent pour rapprocher les milieux de recherche et d’enseignement. D’abord, par la diffusion de savoirs qui parlent au terrain. Mieux encore : par un véritable transfert de connaissances qui transforme alors les savoirs en leviers d’action.
Diffusion ou transfert de connaissances ? Une distinction qui mérite qu’on la clarifie.
Présenter ses résultats en colloque ou publier un article, c’est utile – mais ce n’est pas du transfert. Ce type de communication relève davantage de la diffusion : un échange ponctuel et unidirectionnel, qui permet un rayonnement étendu des connaissances, mais limite les possibilités d’interaction entre les milieux de recherche et d’enseignement. Les savoirs circulent, mais sont peu discutés, plus difficilement adaptés et rarement intégrés sur le terrain. Souvent, la recherche est déjà achevée : l’objectif est alors surtout de donner de la visibilité aux résultats, non d’engager les milieux de pratique dans une réflexion collective.
Qu’on ne s’y trompe pas, la diffusion de connaissances a sa place : elle permet de joindre un large public, de faire connaître des recherches et de susciter l’intérêt. Mais elle reste limitée. À elle seule, elle ne garantit pas que les savoirs se transforment en pratiques. Pour que les connaissances trouvent réellement écho sur le terrain, il faut aller un peu plus loin.
C’est là qu’intervient le transfert de connaissances : un processus interactif qui engage à la fois les milieux de recherche et ceux de la pratique, et requiert un investissement plus soutenu des personnes et des organisations impliquées. Contrairement à la diffusion, souvent linéaire et éphémère, le transfert cherche à créer des liens bidirectionnels durables, à adapter les savoirs aux réalités du terrain et/ou à les intégrer dans l’action (Équipe RENARD, 2025). Le transfert demande donc du temps – une ressource précieuse et souvent rare dans les milieux éducatifs.
L’infographie
Pour y voir plus clair, la revue Pédagogie collégiale s’est penchée sur les façons de mieux comprendre – et représenter – diverses stratégies de diffusion et de transfert de connaissances. Dans son plus récent dossier thématique « La curiosité qui enrichit l’action » (Printemps-Été 2025), elle propose une infographie claire et accessible illustrant diverses stratégies selon leur degré d’interaction entre les milieux de recherche et d’enseignement. Cette synthèse visuelle est le fruit d’une collaboration entre la rédactrice en chef de la revue et l’illustratrice Mélika Bazin.
Source de l’infographie :
Paquette, A.-M. et M. Bazin (2025). « Comment passer de la recherche à l’action ? », Pédagogie collégiale, vol. 38, no 3, p. 6-7.
Des gestes qui rapprochent les milieux
Les actions de diffusion et de transfert ne poursuivent pas tout à fait les mêmes objectifs. Les unes cherchent à informer, les autres à transformer. Elles ne s’opposent pas, mais répondent à des logiques différentes, souvent complémentaires et situées sur un continuum. Leur portée varie en fonction du contexte : type de connaissances à partager, nature des publics concernés, degré d’engagement souhaité. Comme le soulignent Lemire et collab. (2009), il n’existe pas de recette unique. À chacun de trouver la bonne combinaison, au bon moment, en fonction des intentions et des moyens.
Références
Équipe RENARD (2025). « MOOC en transfert de connaissances », [https://www.equiperenard.org].
Lemire, N., K. Souffez et M.-C. Laurendeau (2009). « Animer un processus de transfert de connaissances : bilan des connaissances et outil d’animation », Institut national de santé publique du Québec.
Paquette, A.-M. et M. Bazin (2025). « Comment passer de la recherche à l’action ? », Pédagogie collégiale, vol. 38, no 3, p. 6-7.
Source de l’image : Freepik
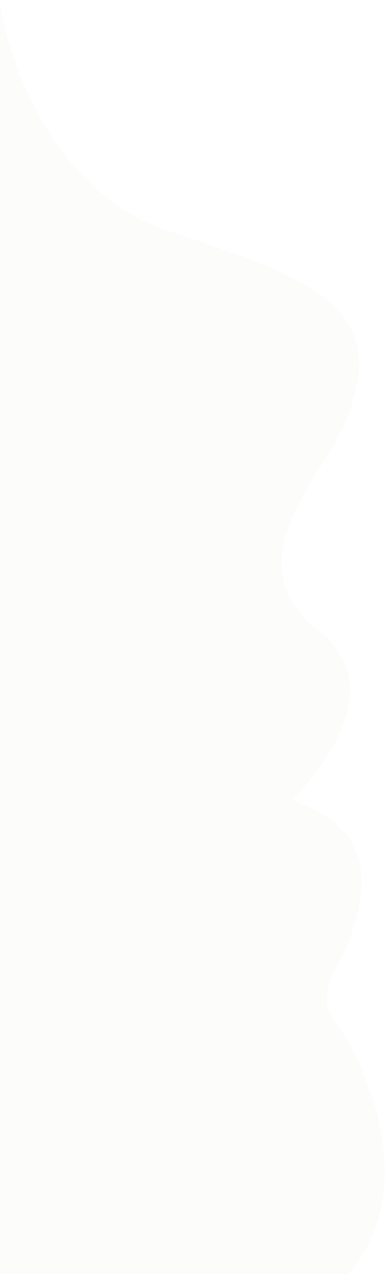
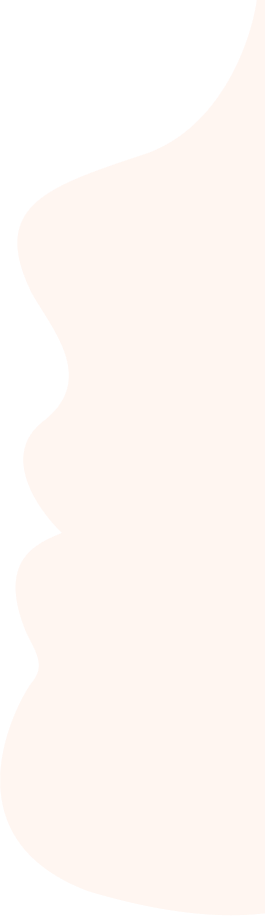
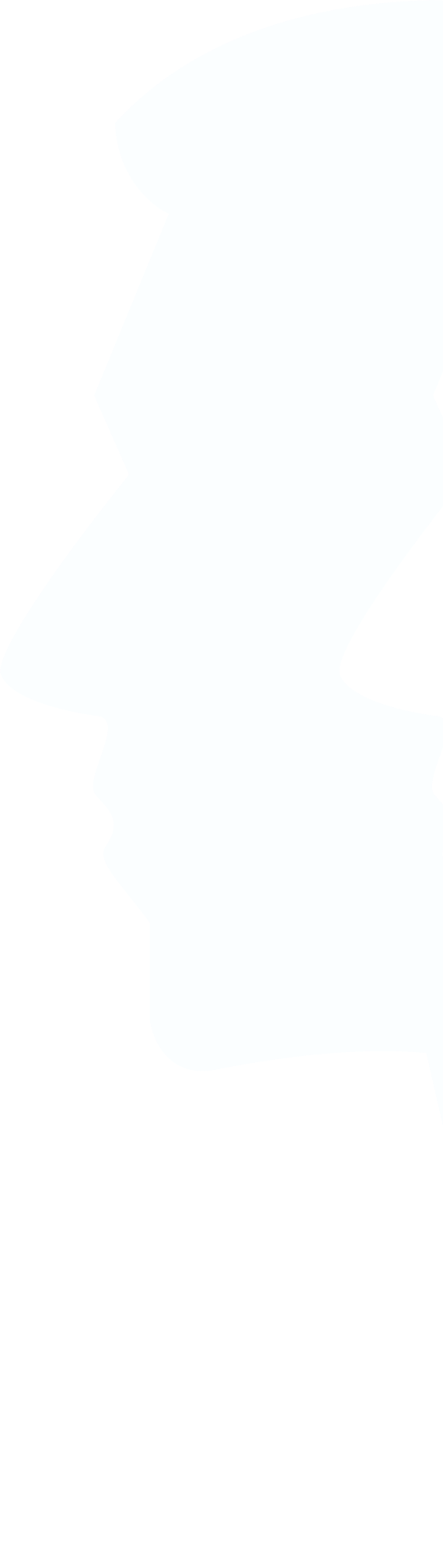
Articles similaires
Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité
Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.
Voir l’articleWikipédia dans la classe
L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.
Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants
Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.
Voir l’articleCommentaires et évaluations
Contribuez à l’appréciation collective



