Comment soutenir le plaisir d’apprendre : point de vue des élèves du secondaire
Dans le paradigme du rapport au savoir (Charlot, 1997), à l’école, on peut apprendre sous contrainte, en pensant que c’est utile, ou avec de l’intérêt et du plaisir. Cet article présente les résultats d’un sondage effectué auprès d’élèves du secondaire en régions québécoises. Les données témoignent du besoin de réincarner le désir d’apprendre afin de ressentir la joie de comprendre et la joie d’accéder à sa propre intelligence.

Source : Shutterstock
Mise en contexte : une huitième compétence
En 2020, le ministère de l’Éducation du Québec a ajouté au référentiel de compétences professionnelles des personnes enseignantes « Soutenir le plaisir d’apprendre ». En vue de l’intégrer dans la pratique enseignante, il est pertinent de porter attention au point de vue des élèves, qui est peu documenté dans la littérature scientifique, alors que cette compétence concerne directement le rapport au savoir et à l’école de ceux-ci.
Lors d’un sondage auprès d’élèves du secondaire, nous partions du principe que « le rapport au savoir, c’est le rapport qu’un sujet entretient avec le fait d’apprendre, avec le savoir en tant que tel, avec l’école et avec lui-même en tant qu’élève » (Charlot, 1997, p. 79) ; et que le plaisir est un état affectif fondamental, une sensation agréable et une force motrice de l’apprentissage (Pu et Xu, 2016).
Le rapport au savoir : utilité, intérêt et contrainte
- Le rapport utilitaire au savoir est lié aux représentations que construisent les élèves lorsque ceux-ci l’associent à un moyen d’atteindre un objectif.
- Le rapport d’intérêt au savoir relève du désir. Ce désir découle, par exemple, de l’aspect interrelationnel, de l’engagement dans les jeux, du bienêtre physique, de l’épanouissement personnel. Ce désir peut aussi être lié à l’activité d’apprentissage en soi. Lorsque l’activité d’apprendre est suffisante à motiver l’élève, l’apprentissage devient un plaisir inhérent.
- Le rapport contraignant au savoir est présent lorsque les élèves se représentent leurs apprentissages comme un effort inutile, un irritant lié aux devoirs, une restriction liée à l’immobilité, une pression des parents, ou encore une obligation.
Le plaisir d’apprendre selon les élèves du secondaire
Avec la collaboration des directions d’école, une boîte à mots anonyme a été installée dans onze écoles secondaires dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Une seule question, à interprétation libre, a été posée aux élèves : Selon toi, qu’est-ce que le plaisir d’apprendre ? Notre intention était de promouvoir leur sentiment de contribution dans une visée de reconnaissance de leur capacité à s’exprimer librement. Les données recueillies entre l’hiver 2024 et l’hiver 2025 auprès de 693 élèves permettent d’observer ces résultats :
- 80 % mentionnent un rapport au savoir lié à l’intérêt ;
- 37 % nomment un rapport au savoir utilitaire ;
- 27 % entretiennent un rapport contraignant au savoir et à l’école. Ces contraintes se retrouvent dans 20 % des énoncés liés à l’utilité et dans 60 % des énoncés liés à l’intérêt.
Comment soutenir le plaisir d’apprendre ?
Le rapport utilitaire au savoir est présent chez plusieurs élèves et cela serait dû au message qu’on doit travailler pour avoir de bonnes notes, et non pour apprendre des choses intéressantes ; ou que l’on doit faire des efforts pour avoir un bon métier, et non pour apprendre des choses « importantes » ou « intéressantes » (Charlot, 1999). Encourager uniquement cette posture risque d’accentuer la motivation extrinsèque et possiblement entraîner chez les élèves un désintéressement (Meirieu, 2014). Conséquemment, cette posture peut effriter le plaisir d’apprendre.
Tandis que dans un rapport au savoir lié à l’intérêt, l’élève prend part à une activité plaisante et donc, il n’a plus besoin de chercher son utilité immédiate (Charlot, 2005). En accord avec Pu et Xu (2016), nos données confirment que « l’intérêt est le meilleur professeur » (p. 206). En rappelant les attentes de bienêtre physique, psychologique et socioaffectif auxquelles les relations doivent répondre, les données témoignent de la nécessité de recentrer cette relation sur la recherche de sens sous-jacente au savoir (Aubert, 2021).
Oscillant entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque (Deci et Ryan, 2006), l’intérêt des élèves qui participent est parfois lié au pouvoir attractif de la matière, de la personne enseignante ou de ses goûts. Ainsi, quand l’enseignant ou enseignante permet de réinternaliser le désir grâce à l’enthousiasme que cette personne a de présenter le savoir, les élèves accèdent à la joie de comprendre, à leur propre intelligence (Meirieu, 2014) et ils ressentent de la fierté.
Ce sondage exploratoire a permis de mettre en lumière le point de vue d’élèves du secondaire de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sur ce qu’est le plaisir d’apprendre pour eux. D’autres études devraient avoir lieu afin d’approfondir nos connaissances sur le sujet et de contribuer à l’intégration de la compétence professionnelle Soutenir le plaisir d’apprendre.
Références
Aubert, J.-L. (2021). Comment motiver son enfant à l’école : lui (re)donner envie d’avoir envie. Odile Jacob.
Charlot, B. (1997). Du rapport au savoir éléments pour une théorie. Anthropos.
Charlot, B. (1999). Le rapport au savoir. In J. Bourdon & C. Thelot (éds.), Éducation et formation (1‑). CNRS Éditions.
Charlot, B. (2005). Le rapport au savoir n’est pas une réponse, c’est une façon de poser le problème. Vie pédagogique, 135, 11-15.
Deci, E. L. et Ryan, R. M. (2006). Self-Regulation and the Problem of Human Autonomy: Does Psychology Need Choice, Self-Determination, and Will? Journal of Personality, 74(6), 1557-1586.
Donnay, J. & Verhoeven, M. (2006). Chapitre 17. La motivation à apprendre : un regard sociologique. Dans B. Galand et É. Bourgeois (dirs.), (Se) motiver à apprendre (p. 195-206). Paris, France: Presses Universitaires de France. doi:10.3917/puf.brgeo.2006.01.0195.
Galand, B., et Bourgeois, E. (2006). (Se) motiver à apprendre. Paris, France : P.U.F.
Meirieu, P., et Daviet, E. (2014). Le plaisir d’apprendre. Autrement.
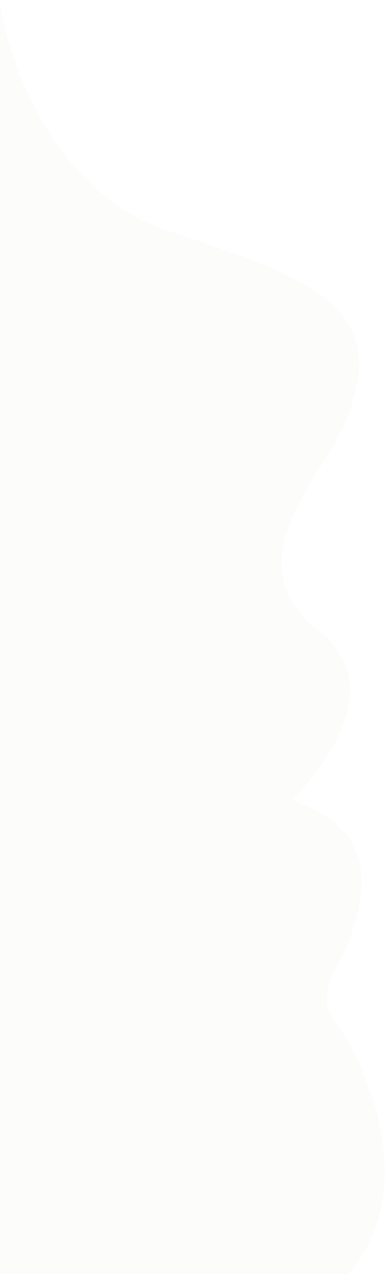
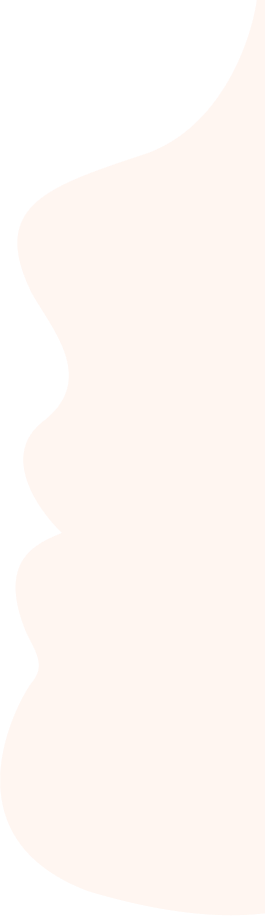
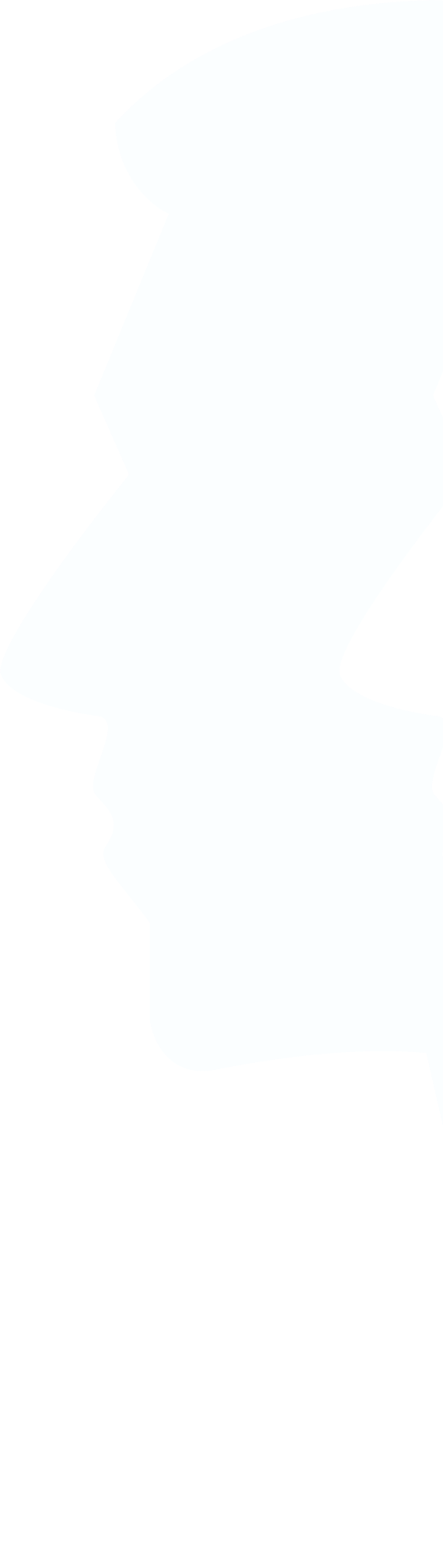
Articles similaires
Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité
Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.
Voir l’articleWikipédia dans la classe
L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.
Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants
Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.
Voir l’articleCommentaires et évaluations
Contribuez à l’appréciation collective
