Du monologue à l’échange : trajectoire des pratiques de questionnement à l’école
Le questionnement constitue une pratique pédagogique à la fois essentielle, courante et exigeante (Shanmugavelu et al., 2020). Lorsqu’il est utilisé de manière réfléchie, il favorise la pensée critique, l’engagement des élèves et l’apprentissage en profondeur (Buchanan Hill, 2016). Hérité de la tradition philosophique, notamment des dialogues socratiques (Macé, 2011), il a progressivement trouvé sa place à l’école, où il s’est transformé au gré des réformes éducatives (Maulini, 2005).

Source de l’image : Shutterstock
Les années 60
À cette époque, la personne enseignante dirigeait l’échange, qui prenait souvent la forme d’un monologue. Il posait de nombreuses questions, jusqu’à 395 par jour au secondaire, selon Stevens (1912, cité dans Maulini, 2005), et évaluait les réponses des élèves sans retour constructif. L’élève y jouait un rôle passif. Dans un tel contexte, les recherches ont démontré que les enseignants et enseignantes laissent généralement moins de deux secondes aux élèves pour formuler une réponse, alors qu’un temps d’attente d’au moins trois secondes favorise une amélioration notable de la qualité des réponses et de la profondeur cognitive (Tobin, 1987).
Les années 80
Durant cette période, un glissement s’amorce : sous l’influence des avancées en psychologie cognitive, les pratiques pédagogiques se réorientent progressivement vers un paradigme centré sur l’apprentissage (Viola et Nadeau, 2022). Le questionnement ne se limite plus à vérifier l’acquisition de connaissances factuelles, mais cherche à faire émerger les raisonnements de l’élève, en privilégiant des questions du type « comment » et « pourquoi », plutôt que simplement « quoi ». On dit de l’élève qu’il est actif en classe.
Les années 2000
Sous l’influence du socioconstructivisme, la réforme des années 2000 a redéfini le questionnement comme un processus dynamique et continu, dans lequel le personnel enseignant et les élèves alternent les rôles de questionneur et de questionné. Ces échanges visent à soutenir la construction des connaissances et le développement des compétences des élèves à travers des tâches complexes et authentiques. La personne enseignante, pour sa part, est appelée à instaurer un environnement ouvert, propice à la participation active des élèves, auxquels elle accorde une place centrale dans le processus d’apprentissage (Maulini, 2005).
Les principes à retenir aujourd’hui
Malgré cette évolution, plusieurs enjeux demeurent : qui a la responsabilité de questionner en classe, selon quelles modalités, et dans quel but ? Ce changement de paradigme soulève des considérations didactiques et pédagogiques majeures qui ont mené à la formulation de diverses recommandations à l’intention du personnel enseignant. Parmi celles-ci, on retrouve l’importance :
- de formuler des questions réflexives portant sur les processus d’apprentissage afin de solliciter différents niveaux de réflexion (McTighe et Wiggins, 2013) ;
- de diversifier les types de questions pour s’adapter aux objets d’apprentissage, aux stratégies et aux compétences qu’il faut développer chez les élèves afin de favoriser la communication de leurs idées (Soysal et Soysal, 2022), de maintenir leur engagement et de soutenir leur autonomie ;
- d’accorder un temps suffisant aux élèves pour formuler leurs réponses afin d’instaurer et de maintenir un climat de classe collaboratif et non anxiogène (Tobin, 1987) ;
- d’instaurer une dynamique de questionnement partagé entre l’enseignant ou l’enseignante et les élèves ;
- d’adopter une posture de questionnement didactique afin de planifier son enseignement, et ce, en fonction des élèves, des savoirs, des stratégies pédagogiques et de son expérience personnelle.
Conclusion
Le questionnement s’est profondément transformé au rythme des réformes éducatives. Bien que son importance soit aujourd’hui largement reconnue, sa mise en œuvre demeure complexe et pose plusieurs défis en contexte scolaire. Il devient donc essentiel de s’appuyer sur certaines balises pour le planifier et l’intégrer efficacement à l’enseignement. L’utilisation de différentes typologies de questions peut s’avérer particulièrement utile à cet égard. Et si l’on souhaite ouvrir la voie à un questionnement partagé avec les élèves, encore faut-il apprendre à accueillir leurs propres interrogations et à y répondre de manière constructive.
Références
Buchanan Hill, J. (2016). Questioning Techniques: A Study of Instructional Practice. Peabody Journal of Education, 91(5), 660‑671. https://doi.org/10.1080/0161956X.2016.1227190
Maulini, O. (2005). Questionner pour enseigner et pour apprendre : le rapport au savoir dans la classe. Esf.
McTighe, J., et Wiggins, G. (2013). Essential questions: Opening doors to student understanding. Ascd.
Shanmugavelu, G., Ariffin, K., Vadivelu, M., Mahayudin, Z., et R. K Sundaram, M. A. (2020). Questioning Techniques and Teachers’ Role in the Classroom. Shanlax International Journal of Education, 8(4), 45‑49. https://doi.org/10.34293/education.v8i4.3260
Soysal, Y., et Soysal, S. (2022). Exploring Science Teacher Questions’ Influence on the Students’ Talk Productivity : A Classroom Discourse Analysis Approach. Sage Open, 12(2), 21582440221102433. https://doi.org/10.1177/21582440221102433
Tobin, K. (1987). The Role of Wait Time in Higher Cognitive Level Learning. Review of Educational Research, 57(1), 69‑95. https://doi.org/10.3102/00346543057001069
Viola, S., et Nadeau, A., (2022). Courants, programmes et approche culturelle de l’enseignement. Dans Raby, C. et Viola, S. (Éd.), Modèles d’enseignement et théories d’apprentissage : Pour diversifier son enseignement (pp. 2–13). Éditions CEC.
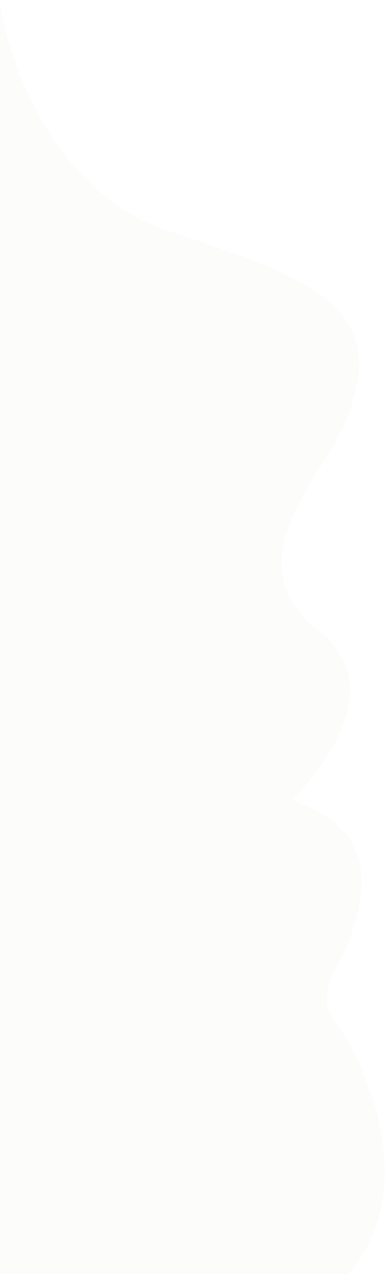
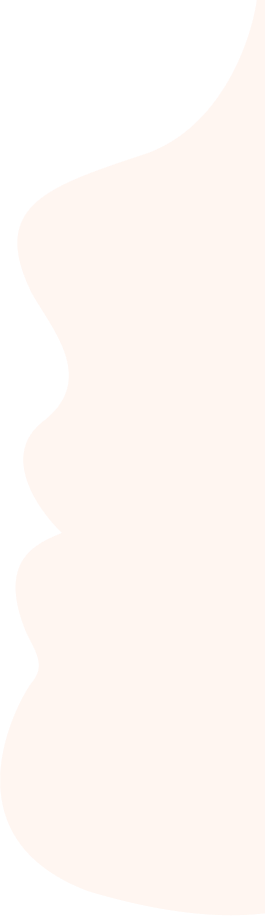
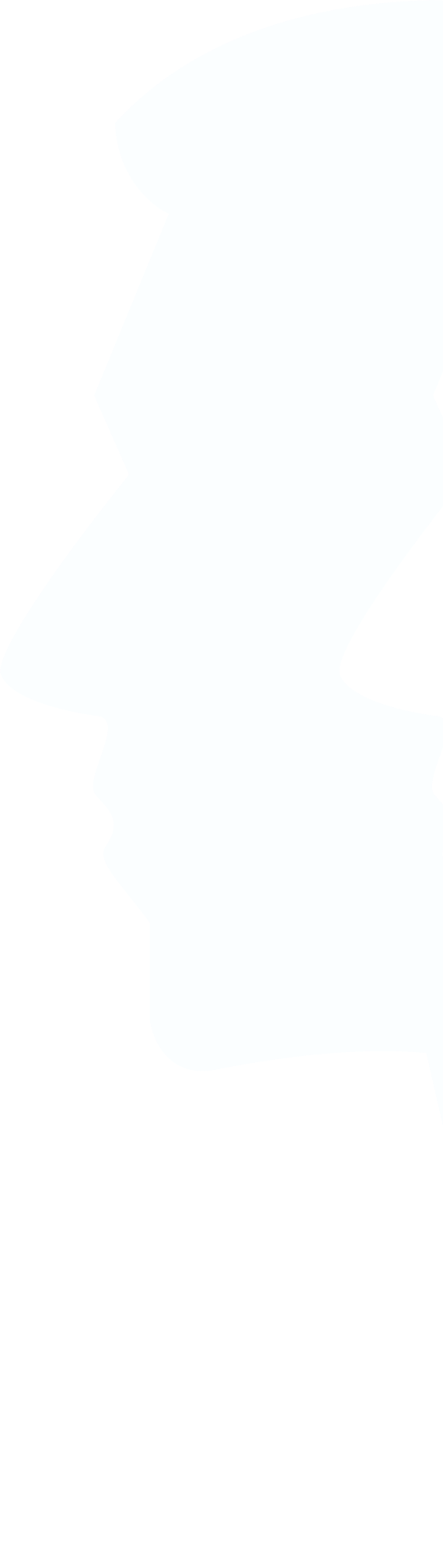
Articles similaires
Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité
Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.
Voir l’articleWikipédia dans la classe
L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.
Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants
Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.
Voir l’articleCommentaires et évaluations
Contribuez à l’appréciation collective
